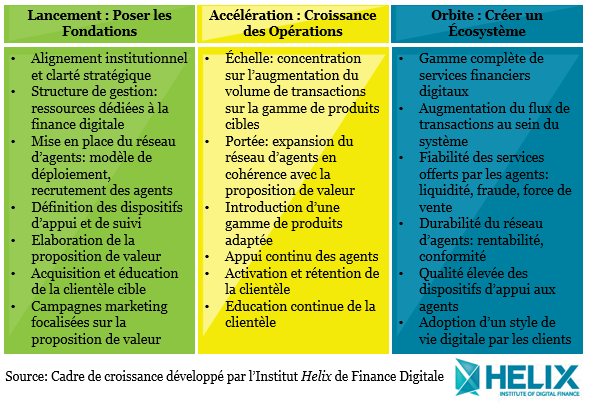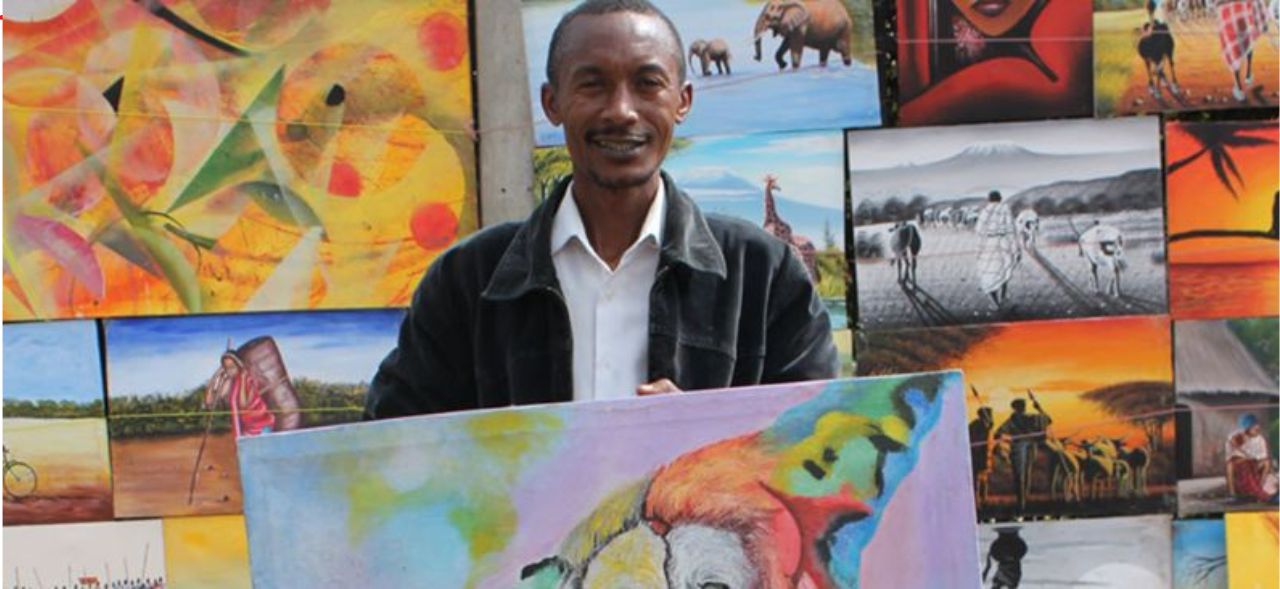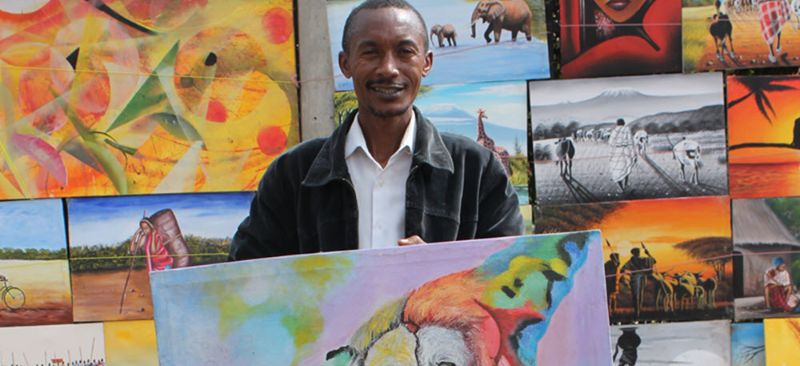Respecter l’engagement en faveur de l’égalité entre hommes et femmes en concevant de meilleurs produits financiers pour les femmes pauvres
 Abhishek Gupta, Akhand Tiwari, Bhavana, Srivastava et Sunitha Rangaswami, octobre 2018
Abhishek Gupta, Akhand Tiwari, Bhavana, Srivastava et Sunitha Rangaswami, octobre 2018
Cet article est le résultat de plusieurs années de recherches et d’interventions de conseil de MicroSave Consulting (MSC) sur le développement de services financiers destinés aux femmes. Il s’appuie sur des informations provenant de nombreux secteurs, dont notamment la micro-finance, les services financiers digitaux, le versement direct de prestations, les MPME, les réseaux d’agents, etc.
Les spécialistes marketing d’un nombre croissant de secteurs ont fait des efforts considérables pour créer des marchés de consommation segmentés en fonction du sexe, qu’il s’agisse des produits d’hygiène, des deux-roues ou des forfaits de vacances. Pourtant, dans leur grande majorité, les prestataires de services financiers (PSF) continuent d’ignorer les besoins spécifiques des femmes. À l’heure actuelle, il n’existe dans le monde qu’un nombre limité de produits financiers conçus spécialement pour la clientèle féminine.
À l’échelle de la planète, plusieurs facteurs influencent les besoins des femmes. Ils peut s’agir, entre autres, des différences biologiques, au sens où ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde, des obstacles socio-économiques, dans la mesure où elles assument à elles seules le fardeau non rémunéré des corvées domestiques, et du contexte culturel, qui est source de barrières à l’emploi, voire au déplacement. Ces difficultés sont amplifiées pour les femmes pauvres, qui manquent d’instruction et se heurtent à des obstacles qui limitent leur accès à la propriété et au contrôle des biens matériels ou financiers. D’après les statistiques Findex 2017, l’écart entre les sexes en termes d’accès aux comptes s’est réduit de 20 % à 6 % en Inde, mais 35 % seulement des femmes en sont des utilisatrices actives contre 47 % des hommes.
C’est probablement le mouvement du microcrédit qui s’est efforcé, pour la première fois, de reconnaître les femmes pauvres en tant que segment distinct du marché des services financiers. Il les a intégrées au monde financier formel avec des prêts et des passeports émis à leur nom. Cette approche ne représente toutefois qu’un progrès limité. Les responsables politiques et les bailleurs de fonds ne voient pas nécessairement dans les femmes pauvres des consommatrices actives de services financiers. Ils les considèrent plutôt comme un moyen de toucher les ménages et d’y faire entrer le crédit dans l’espoir qu’ils finiront par sortir de la pauvreté.
Il existe peu de données sur le développement et la réussite des entreprises dirigées par des femmes ayant bénéficié de financements de microcrédit. Dans la pratique, beaucoup de ces bénéficiaires finissent par vivre au jour le jour en ayant du mal à honorer les échéances de leurs prêts.
Dans le même esprit, un certain nombre de pays en développement ont instauré il y a une vingtaine d’années le versement d’allocations soumises à conditions (« CCT » pour Conditional Cash Transfer). L’idée était de lier le versement de certaines prestations sociales à des comptes bancaires ouverts au nom des femmes. Ces versements étaient liés à certains critères devant être respectés par les bénéficiaires, comme par exemple la scolarisation de leurs enfants, l’accouchement en milieu hospitalier ou la protection des enfants de sexe féminin. Globalement, ces CCT mettaient l’accent sur le bien-être social de l’entité familiale, plutôt que sur le bien-être économique des femmes bénéficiaires en tant que telles.
Dans ce modèle, les femmes sont assimilées à la « famille » et sont considérées comme un vecteur de bien-être social. Les prestataires de services financiers sont le réseau de distribution des CCT et de la micro-finance. Ils ont fait preuve d’un manque étonnant de volonté et d’imagination pour détecter une opportunité commerciale dans les millions de femmes pauvres qui détiennent ainsi un compte bancaire dans leurs agences.
Quelles sont les lacunes de la conception de produits financiers destinés aux femmes pauvres ?
Les femmes pauvres se heurtent à des barrières sociales, économiques et psychologiques qui les empêchent de participer pleinement à l’écosystème des services financiers. Ces femmes veulent être des acteurs économiques indépendants tout en répondant aux besoins de leur famille. Nous recensons ci-dessous quelques uns de ces défis :
- L’un des aspects les moins étudiés, et donc peu connu, de la conception de services financiers est le niveau élevé d’oralité chez les femmes pauvres. L’illettrisme et l’innumérisme constituent des obstacles cognitifs qui les empêchent de se sentir à l’aise avec les prestataires de services financiers ou leurs agents. Il est fréquent que les hommes profitent de ce handicap et s’en servent comme d’une excuse pour traiter avec les prestataires de services financiers « au nom » des femmes de leur entourage, dont ils affirment qu’elles « se feraient sinon avoir ou seraient incapables de faire des opérations ». Cela restreint leur expérience des services financiers et les conduit à douter de leur capacité à accéder à des services financiers ou non financiers, y compris au moyen des plateformes digitales.
 La présence d’agents de sexe féminin se traduit par un taux d’adoption plus élevé des services financiers digitaux au sein de la clientèle féminine. Les clientes leur font davantage confiance et considèrent qu’elles respectent mieux leur confidentialité par rapport aux agents masculins, ce dont les prestataires de services financiers ne semblent pas tenir compte. Des observations réalisées en Inde laissent à penser que les prestataires de services financiers ne consacrent pas autant d’efforts au recrutement et au soutien d’agents de sexe féminin qu’ils ne le font pour les hommes. De plus, les femmes pauvres sont sensibles au coût des frais facturés par les agents et mettent plus longtemps à faire confiance à un agent particulier. Par rapport aux hommes, elles ont donc besoin d’échanger davantage avec leur agent. Cependant, certaines pratiques sociales existantes, comme par exemple le système de purdah ou les restrictions relatives à leurs déplacements, limitent leur accès aux services financiers, notamment dans les zones rurales isolées.
La présence d’agents de sexe féminin se traduit par un taux d’adoption plus élevé des services financiers digitaux au sein de la clientèle féminine. Les clientes leur font davantage confiance et considèrent qu’elles respectent mieux leur confidentialité par rapport aux agents masculins, ce dont les prestataires de services financiers ne semblent pas tenir compte. Des observations réalisées en Inde laissent à penser que les prestataires de services financiers ne consacrent pas autant d’efforts au recrutement et au soutien d’agents de sexe féminin qu’ils ne le font pour les hommes. De plus, les femmes pauvres sont sensibles au coût des frais facturés par les agents et mettent plus longtemps à faire confiance à un agent particulier. Par rapport aux hommes, elles ont donc besoin d’échanger davantage avec leur agent. Cependant, certaines pratiques sociales existantes, comme par exemple le système de purdah ou les restrictions relatives à leurs déplacements, limitent leur accès aux services financiers, notamment dans les zones rurales isolées.- L’indépendance financière et le bien-être socio-économique plus général des femmes pauvres dépendent, en partie, de l’accès à une pièce d’identité individuelle. En l’absence de justificatif d’identité valable, elles ne peuvent pas se soumettre aux obligations de vérification de l’identité des clients (« KYC », de l’anglais Know-Your-Customer), y compris pour accéder aux services financiers digitaux. Le programme Bhamashah du Rajasthan en Inde fournit un exemple de première étape utile pour donner une identité digitale aux femmes. Les interfaces digitales doivent en outre garantir la sécurité et le respect de la vie privée des femmes.
- Les petites et micro-entreprises dirigées par des femmes ont non seulement du mal à accéder au capital, mais aussi à officialiser leur existence juridique. Cela limite leurs efforts de développement commercial et leur participation aux canaux de distribution du commerce en ligne et représente une opportunité commerciale significative que les prestataires de services financiers n’ont pas su exploiter jusqu’à présent. Avec un soutien prolongé, les micro-entrepreneuses sont parfaitement capables de développer leur activité. Des études ont montré que les entreprises contrôlées par des femmes ont de meilleurs historiques de remboursement, avec un niveau de prêts non productifs inférieur de 30 à 50 % à celui des entreprises dirigées par les hommes, et sont susceptibles de s’équiper de davantage de produits (jusqu’à trois fois plus) que les hommes. Cela en fait un excellent segment pour réaliser des ventes croisées.
- Dans leurs relations avec les prestataires de services financiers, les femmes chefs d’entreprise attendent plus que des produits financiers. Elles souhaitent bénéficier de services de conseil aux entreprises en matière de gestion, de comptabilité, de renforcement des compétences et de procédures juridiques pour développer les activités pour lesquelles elles avaient recherché des financements auprès de ces prestataires.
Concevoir des produits financiers pour les femmes pauvres : grandes lignes
À l’échelle de la planète, un milliard de femmes restent financièrement exclues, tandis qu’un décalage persistant de 9 % entre hommes et femmes perdure dans les pays en développement. Il est important et urgent que les prestataires de services financiers innovent pour développer des produits destinés aux femmes pauvres qui permettront de combler ces décalages. La conception de ces produits devra tenir compte de la diversité des besoins du marché de masse féminin.
Le succès du mouvement du microcrédit a reposé en grande partie sur son approche de solidarité collective. Les femmes pauvres préfèrent travailler et sont rassurées dans un environnement de groupe. Une approche collective réduit le risque financier au sein d’un même groupe et permet de mettre en commun les ressources, qu’il s’agisse d’actifs, de temps ou de main d’œuvre. Les prestataires de services financiers ont tout intérêt à s’appuyer sur cet aspect essentiel au vu de son influence considérable sur l’adoption des services financiers personnels par les femmes pauvres.
Impliquer des hommes pour défendre l’autonomie des femmes (économique ou autre) renforce la masse critique qui permet d’instituer une dynamique de changement. Cela est particulièrement important dans les régions où les normes sociales imposent un statu quo de contrôles rigoureux sur les femmes. De plus, les campagnes promotionnelles utilisées par les prestataires de services financiers pour développer l’usage de services financiers formels par les femmes pauvres devraient mettre en avant leurs avantages potentiels pour les ménages comme pour les intéressées.
D’autres aspects méritent d’être pris en compte pour la conception de produits financiers destinés aux femmes pauvres :
 Considérer les femmes pauvres comme un segment de clientèle proprement dit, et non comme un simple moyen de toucher les ménages. Cela implique un mix-produit élargi, la possession d’une identité et une distribution respectueuse des contraintes féminines pour surmonter les limitations rencontrées par ce segment en termes de mobilité. Cela passe également par une offre complémentaire de services non financiers, dans le domaine par exemple des mises à niveau technologiques, du développement des compétences, de la comptabilité et de la formation comptable.
Considérer les femmes pauvres comme un segment de clientèle proprement dit, et non comme un simple moyen de toucher les ménages. Cela implique un mix-produit élargi, la possession d’une identité et une distribution respectueuse des contraintes féminines pour surmonter les limitations rencontrées par ce segment en termes de mobilité. Cela passe également par une offre complémentaire de services non financiers, dans le domaine par exemple des mises à niveau technologiques, du développement des compétences, de la comptabilité et de la formation comptable.- Adapter les services financiers digitaux aux besoins des femmes pauvres. Cela implique d’utiliser délibérément une imagerie tirée de leur vie quotidienne dans les interfaces digitales de façon à ce qu’elles puissent faire intuitivement le rapprochement avec l’interface et la conception du produit. Il est également nécessaire de développer des canaux de distribution adaptés.
- Soutenir les agents de sexe féminin, qui sont également des micro-entrepreneurs de plein droit et élargissent par conséquent la base de clientèle féminine.
- Fournir des outils financiers au nombre croissant de femmes employées dans l’ensemble des chaînes de valeur des grandes entreprises et leur apporter des solutions adaptées, comme par exemple des services de conseil aux entreprises ou des réseaux destinés aux femmes.
- Faire de la centralité du genre un état d’esprit et une priorité de la conception de produits, tout en faisant attention à l’impact potentiel de chaque détail de conception sur la vie quotidienne des femmes pauvres.Les données CCT pourraient par exemple permettre de développer un produit de crédit formel destiné aux femmes bénéficiaires, pour lequel le respect des contraintes de versement servirait d’indicateur de mesure de la discipline financière et des flux de trésorerie.
- Utiliser l’analyse des données de masse pour interpréter les données désagrégées en fonction du sexe, et plus particulièrement : évaluer et suivre les avantages de l’offre de services financiers en faveur des femmes pauvres, que ce soit en termes de remboursements ou de retombées sociales pour les ménages ; et mesurer les flux de capitaux en direction des MPME dirigées par des femmes dans l’ensemble des classes d’actifs et véhicules d’investissement et évaluer leur corrélation avec les retombées financières et sociales tangibles au niveau des personnes et des ménages.
- Utiliser ces données pour montrer comment la finance peut être un outil de transformation de la vie des femmes pauvres et positionner ainsi les prestataires de services financiers comme des artisans d’un véritable changement social.
Faute de considérer les femmes pauvres comme un segment distinct ayant des besoins spécifiques, nous finirons par déguiser des produits conçus pour les hommes en produit soi-disant mixte ou donner une connotation féminine superficielle à des produits par ailleurs génériques. Pour favoriser ce changement, nous devons étudier la myriade de parcours-client des femmes pauvres et utiliser ces connaissances pour concevoir une offre de produits adaptée.
Le double avantage de s’engager dans cette voie est la possibilité de transformer la vie des femmes pauvres tout en apportant une proposition de valeur commerciale aux prestataires de services financiers. Une base de clientèle de plus d’un milliard de femmes, qui ne sont pas encore connectées aux services financiers et restent encore largement ignorées, les attend.